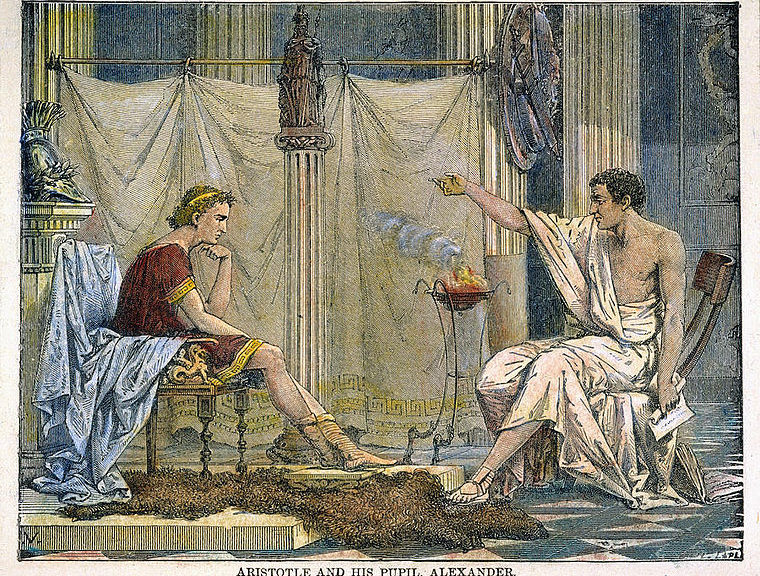ARISTOTE: une éthique des vertus
La lecture des textes d’Aristote ne va pas sans quelques difficultés. D’ailleurs, les traducteurs et les spécialistes n’ont de cesse d’argumenter et justifier leurs interprétations. Cette situation est en partie due au fait que le corpus des textes aristotéliciens est issu d’un ensemble de manuscrits médiévaux, plus ou moins fragmentaires, éloignés dans le temps des originaux rédigés par le philosophe grec. Le style se présente aussi avec une certaine aridité dans la mesure où il semble que ces textes étaient dédiés à un enseignement oral, un peu comme s’il s’agissait de prises de notes relevant, selon certaines hypothèses, du travail des disciples d’Aristote. Les méthodes d’analyse représentent aussi un défi pour le lecteur d’aujourd’hui. Puisqu’elles procèdent par voie d’implications logiques afin de comparer et classifier le fruit des observations du philosophe, elles sont souvent formulées dans un langage abstrait. Ce processus de réflexion, tout en ayant pour objectif de découvrir les caractéristiques générales et spécifiques de l’ensemble de ces choses qu’il s’agit de définir, présente aussi de subtiles argumentations pour lesquelles certains des enjeux nous échappent. En ce sens, nous nous retrouvons devant une pensée en action indissociable du contexte historique qui l’a vu naître. Notons cependant que même s’il y a difficulté, la possibilité que nous soyons impressionnés par la richesse et la complexité de ces analyses conceptuelles fait partie d’une telle expérience de lecture.
À ces aspects formels, plus ou moins faciles à maîtriser, s’ajoutent ceux qui relèvent à proprement parler du domaine des idées, des théories et des conceptions philosophiques. La finalité qui sous-tend la démarche d’Aristote peut aisément entrer en conflit avec nos propres habitudes de pensée. Les jugements de valeurs concernant le beau et le bien sont aussi susceptibles d’apparaître beaucoup moins évidents pour nous qu’ils pouvaient l’être aux yeux d’un Grec de l’Antiquité. L’idée de vertu elle-même, ainsi que les moyens pratiques suggérés par Aristote pour nous perfectionner et atteindre à l’excellence, se présentent aussi comme un motif de réflexion particulièrement exigeant. Qui voudra tendre à la vertu, telle qu’elle est définie dans l’Éthique à Nicomaque, comprendra aisément que pour être courageux, généreux, magnanime ou savoir user des plaisirs, avec tout l’équilibre qu’impose la conception du juste milieu du Stagirite, il nous faut prendre en compte une réelle tension entre ce que sont les défauts et les excès de nos comportements. Ajoutons à tout cela que l’utilisation de la conception aristotélicienne du bonheur pour comprendre notre société et jeter un regard sur notre propre culture peut provoquer de véritables remises en question.
Reprenons ces questions philosophiques pour mieux en comprendre à la fois les enjeux et leur imbrication. Commençons par le problème que représente le recours à l’idée de finalité lorsqu’il s’agit de définir et concevoir la nature des phénomènes que nous observons. Si par exemple je cherche à définir l’éducation je peux, partant de l’observation des différentes institutions qui constituent cette activité humaine, me demander quel est leur but, leur sens et leur fonction en réfléchissant aux raisons qui légitiment le fait que nous éduquions les enfants. Ce faisant, je pourrais être amené à affirmer que la fin de l’éducation consiste à former des humains capables de réaliser leur plein potentiel tout en contribuant à l’avancement de la société. Il se peut très bien que ma définition soit critiquable, mais il n’en demeure pas moins qu’en exprimant le sens que j’attribue à ce phénomène social j’aide à faire comprendre ce que représente l’éducation. La médecine, dira Aristote, a pour but la santé, la stratégie militaire la victoire, l’architecture la construction de maison et autres bâtiments, etc. Ainsi dans chaque cas nous voyons que ce qui définit le phénomène observé c’est la réalisation de la finalité vers quoi chaque chose tend. C’est ce qu’Aristote nomme l’entéléchie. Le procédé est intéressant car si quelqu’un me demande qu’est-ce qu’un œil et que je lui réponds qu’il s’agit d’un organe ayant pour fonction d’assurer la vue, je caractérise mon objet en m’appuyant sur un certain type de causalité (soit son but ou ce que l’aristotélisme concevait comme la cause finale), tout en lui attribuant une signification. Or il n’est pas rare que nous utilisions la finalité ou l’impression de finalité pour chercher à comprendre les choses. Nous sommes constamment en train de nous demander pourquoi par exemple telle personne agit de telle ou telle manière en cherchant à voir ce qui la motive, quelles sont ses intentions ou ses buts. C’est qu’en nous appuyant sur l’adaptation des moyens utilisés pour atteindre des fins, nous avons le sentiment de découvrir ce qui constitue l’organisation d’un ensemble. Le problème qui découle de cette attitude repose sur le fait que le résultat de ces observations implique un processus d’interprétation plus ou moins adapté aux critères de scientificité modernes. En science, telle que nous la pratiquons aujourd’hui, ce n’est pas le sens que nous attribuons aux choses qui détermine une explication, mais la possibilité expérimentale de la vérification des faits. Aussi bien, en science moderne, seule importe la cause efficiente pour parler le langage d’Aristote. En morale et en politique, par contre, il n’est pas rare que la valeur – et donc le sens – des actions ait une grande importance sur le plan pratique.
Revenons au début de l’extrait de l’Éthique à Nicomaque qui nous intéresse. Aristote s’interroge quant à la nature du souverain bien. Ce faisant, il nous apprend qu’il s’agit d’une sorte de but ultime en vue duquel nous agissons, une fin parfaite qui comprendrait aussi la réalisation de tout choix réfléchi et qu’en réalité « s’il y a une fin, quelle qu’elle soit pour toutes les actions possibles, ce serait elle le bien réalisé ». Cette idée générale est évidente dès lors que nous adoptons la finalité comme fil conducteur de la réflexion. Mais aussi lorsque nous nous engageons dans ce type d’effort d’abstraction pour dégager ce qui est commun à toutes les actions. En réfléchissant bien, nous constatons que cette hiérarchisation en lien avec la réalisation d’un bien suprême implique l’idée qu’il y a des différences qualitatives entre les biens (ou les fins) ainsi que des étapes à franchir dans l’atteinte de la perfection. La perfection, rappelons-le, étant pour chaque chose la réalisation de sa nature, en un mot sa vertu (arèté). Or quel sera l’accomplissement de la vertu chez l’humain? Selon Aristote, cet accomplissement serait atteindre au bonheur en agissant de manière à ce que chacune de nos capacités et nos dispositions expriment l’excellence qu’exige pour un animal rationnel la vie en société. Agir en toutes choses conformément à la raison, ou à la partie rationnelle de l’âme, comme l’exprime Aristote, sera par conséquent la pleine réalisation du Souverain Bien et caractérisera la vie bonne ou heureuse. Il serait intéressant de réfléchir à ce que peuvent être ces vertus dans le contexte des normes et valeurs contemporaines.